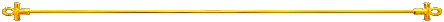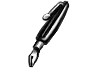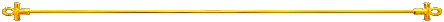
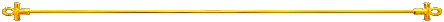
L'agriculture de l'ancienne Egypte était liée aux providentielles inondations du Nil. Le cycle agricole comptait trois saisons : akhet, peret et chemou Les quatre mois pendant lesquels la crue du Nil recouvrait les terres, les paysans devaient pourvoir à la manutention des canaux qui répartissaient l’eau dans les différents lotissements. Une fois le fleuve rentré dans son lit, lorsque le terrain était encore souple, il fallait procéder au labourage et aux semailles. Les Egyptiens possédaient une charrue assez légère, avec un soc en bois, qui était attachée à une paire de bœufs, tandis que les paysans semaient. Ensuite, on libérait les troupeaux sur le terrain et, avec leurs sabots, ils enterraient le grain. La saison la plus fatigante était celle de la récolte. L'on moissonnait le blé avec des faucillons de bois à lame de silex, et les épis étaient placés dans des filets ensuite transportés à dos d'âne sur l'aire où ils étaient entassés afin d'être piétinés par des ânes et des bœufs. Le grain ainsi battu était ensuite jeté en l'air avec des pelles et des fourches de bois pour que le vent sépare les graines de la balle. Enfin, le blé était mesuré, mis en sacs et rangé dans les greniers. Depuis une lointaine époque, la viticulture était bien développée. Le raisin était récolté à la main et les grappes étaient placées dans des cuves où elles étaient ensuite foulées au pied pour en faire sortir le moût qui coulait dans des récipients spéciaux où il était conservé jusqu'à fermentation. |
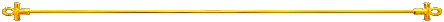
A partir de l’époque de l’Ancien Empire, des statuettes en calcaire peint ou en bois représentant des serviteurs au travail sont déposées dans les tombes. Elles nous fournissent une image extrêmement animée de la vie quotidienne dans l’ancienne Egypte. Leur fonction était de faire en sorte que le défunt ne soit jamais dépourvu des produits de première nécessité. Ces statuettes représentent pour la plupart des femmes transportant des paniers remplis de nourriture et des jarres d’eau. La figurine de la servante à genoux préparant la farine en moulant le blé avec une pierre est fréquente. Une autre opération importante et souvent reproduite à travers les maquettes et les sculptures est la production de la bière : une servante filtre les petits pains d’orge dans une cuvette pour ensuite en presser le jus. Plusieurs maquettes nous montrent l’intérieur d’un grenier à blé où les statuettes des serviteurs les représentent en train de transporter des sacs de blé et de les emmagasiner sous la surveillance d’un scribe. Le métier de potier était considéré comme pénible : les tours étaient en effet difficiles à utiliser car ils n’étaient pas actionnés à l’aide de pédales ; il fallait les faire tourner avec la main gauche pendant que la droite modelait le vase. La filature et le tissage du lin étaient des professions typiquement féminine. La fibre, après avoir été mouillée et battue, était enroulée autour d’un fuseau de bois. Pour le tissage, on utilisait un métier à tisser horizontal sur lequel on passait un peigne pour resserrer la trame. Pendant le Nouvel Empire apparaissent les métiers verticaux, semblables à ceux du monde classique. |
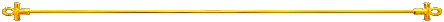
La voie de communication la plus importante de l’antique Egypte était le Nil. La profondeur de ses eaux et les brises constantes provenant de la Méditerranée permettaient en effet la navigation en toutes saisons. |
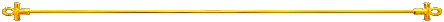
Les cannaies des marais du delta étaient peuplées de nombreuses espèces de volatiles : cailles, perdrix, pélicans, hérons, colombes, pies, hirondelles et toutes sortes de canards. La chasse aux oiseaux était pratiquée en groupe, avec des filets et des pièges. Le désert de Libye et les montagnes du désert oriental offraient une grande quantité d'animaux qui ont à présent disparu. La chasse à pied, avec le lévrier, était particulièrement prisée par les nobles. L’arme la plus utilisée était l’arc, qui mesurait environ un mètre de long ; les flèches, dans un carquois de cuir, étaient différentes en fonction du gibier à abattre. On utilisait le bâton comme une lance, une sorte de "boomerang" qui demandait une habileté extrême. Les nobles égyptiens traquaient le léopard et le lion, mais ils espéraient toujours rencontrer des animaux que nul n'avait encore vus, comme le mystérieux "achech", mi-oiseau et mi-lion, ou encore le Sphinx à tête humaine et corps de lion. La chasse en bige (char à deux ou quatre roues) se diffusa à partir de la XVIIIe dynastie, avec l'avènement de la nouvelle classe de pharaons guerriers. Les eaux du Nil et des canaux étaient peuplées de poissons-chats, de barbeaux, de perches, de carpes et d'autres poissons typiquement africains. L'on pratiquait la pêche à la ligne ; les hameçons étaient fixés à une ligne faite de crin de cheval. Les chaluts (filets) étaient tirés depuis la rive du canal. Des nasses d'osier spéciales étaient traînées depuis les bateaux dans le fleuve, ou encore placées dans les endroits peu profonds. |
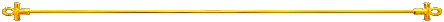
L'élevage des bovins était l’une des principales ressources de l’ancienne Egypte. Les bovins étaient minces comme des antilopes et tachés de brun ou de noir, comme ceux de nos jours. A partir des races de bovidés présentes dans le Sahara dès la préhistoire, les bovins du Nil supérieur et les zébus africains, les Egyptiens obtinrent un grand nombre de races bovines. Les peintures, depuis l'Ancien Empire jusqu'à une époque plus récente, montrent en effet une augmentation élevée des variétés. Un soin particulier était apporté à l'alimentation de ces animaux, au point que souvent l'on voit des scènes où un bœuf est nourri de pain ou de pâtes préparées spécialement pour lui. Avec le temps, l'élevage devint en Egypte une activité hautement spécialisée. Les oies et les autres oiseaux domestiques étaient engraissés de force. Contrairement à ce qui se passe de nos jours, en Egypte l'on élevait les cochons. L'élevage des ânes et des chèvres, et aussi celui des antilopes, des gazelles ou des mouflons, était pratiqué par les riches agriculteurs, qui capturaient ces animaux dans le désert et les apprivoisaient. Parmi les animaux de compagnie, outre le chien et le chat, le singe était très apprécié ; il était dressé pour grimper aux arbres et récolter les dattes ou d’autres fruits. |
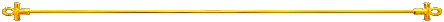
Tout Egyptien, quelle que soit sa condition sociale, pouvait espérer améliorer sa position en se soumettant au dur apprentissage des lettres et de l’arithmétique. Les écoles, dirigées par les scribes, dépendaient de la cour. Il y avait également des écoles privées gérées par des prêtres. Les enfants entraient à l’école à l’âge de cinq ans et en sortaient à quinze, prêts à entreprendre la carrière administrative. La formation consistait essentiellement en l’apprentissage des signes de l’écriture, par le biais d’exercices de copiage très ennuyeux. Le travail du scribe consistait à rédiger les registres d’entrées et de sorties des aliments dans les magasins de la cour ou dans les greniers à blé des grands sanctuaires. Le scribe assistait aussi le nomarque pour recouvrer les impôts dans les différentes provinces du royaume. Les arts figuratifs reproduisent souvent le scribe assis, dans la position traditionnelle du lotus, les jambes croisées, son rouleau de papyrus ouvert sur ses genoux et la plume à la main ; à côté de lui est posé l’étui en bois où étaient conservées les plumes et qui lui servait aussi de palette pour préparer les couleurs. L’habillement du scribe le distingue des gens du peuple : il porte toujours une sorte de jupette courte et trapézoïdale, et ses cheveux sont coupés courts, en calotte. Les scribes étaient souvent non seulement des comptables, mais aussi de véritables intellectuels : c’est à eux que l’on doit la composition des œuvres littéraires que les papyrus nous ont transmises. |